on père a vécu la majeure partie de son enfance juste à côté de la « ligne verte » qui divisait Beyrouth en deux, dans un immeuble de deux étages, mal conçu et abîmé, aux murs corail et aux volets verts. Bien qu’en bonne partie effondré et portant les cicatrices de la guerre, il est toujours là, caché parmi les bâtiments plus robustes de la rue Mar Maroun. La cour de récréation de l’école voisine matérialisait le souvenir de la terreur qui avait autrefois envahi la région. Mon père m’avait raconté : « Lorsque Ain El Remmaneh était assiégée, quiconque mourait était placé dans un sac en plastique et jeté dans la cour de récréation de l’école Seid. Cette cour était pleine des cadavres de ceux qui étaient morts sans raison ».
Un wagon de train positionné en travers de la rue bloquait le passage de l’est à l’ouest de Beyrouth. Des containers remplis de sable étaient empilés sur le dessus pour empêcher les snipers de tirer sur les passants. Les gens ne pouvaient pas marcher dans la rue pour faire leurs courses. Lorsqu’ils avaient besoin d’aller au magasin, ils se hâtaient d’un bâtiment à l’autre en passant par les trous dans les murs. « Nous ne pouvions même pas ouvrir les fenêtres », me raconta mon père. « Nous disposions nos matelas dans le couloir intérieur de notre maison dès que les bombardements commençaient. Ainsi, un obus devait traverser deux murs avant de nous atteindre. Une fois, une bombe a explosé juste au-dessus de notre chambre, et parfois, en regardant dehors, je voyais des balles arriver vers nous puis laisser leur marque sur les murs extérieurs… Nous n’avions pas d’électricité, pas de lign téléphonique et pas d’eau. Nous mangions régulièrement du pain moisi. Le pire, c’étaient les meurtres et les enlèvements arbitraires. »
Des clichés dystopiques de Beyrouth inondent mon esprit chaque fois que mes parents racontent des histoires de guerre. Comme mes parents, de nombreux Libanais ont dû vivre longtemps après la guerre avec ce que Samir Khalaf appelle « les séquelles spécifiques de la terreur et des conflits collectifs ». Cette série de guerres par procuration menées sur notre terre s’est terminée sans résolution claire. Ces massacres et ces dégâts colossaux ont été vains.
Par où commencer pour raconter les malheurs qui ont frappé ce pays au cours des quelque cent dernières années ? Devrais-je commencer par la guerre entre druzes et chrétiens de 1860 qui a fait des milliers de morts ? Devrais-je raconter la famine de masse des Libanais pendant la Grande Guerre, alors que le règne de 400 ans de l’Empire ottoman tremblait et s’effondrait et que le mandat français de 1920 se préparait dans les coulisses ?

Marten Bjork
Les troupes françaises quittèrent le Liban en 1946. Avec le recul, nous savons trop bien que la jubilation de la concrétisation de notre autonomie tant attendue a vite tourné au deuil. Une série d’événements calamiteux mêlés à des interférences extérieures ont conduit à la guerre civile de 1975, un morceau d’histoire encore si controversé qu’on l’omet dans nos manuels scolaires. Je n’étais pas là pour assister aux atrocités, mais leurs ombres me suivent encore, et suivront les générations à venir.
Je suis née en décembre 1991. La guerre venait de se terminer et le Liban prenait un nouveau départ. C’est en tout cas ce que nous voulions croire. Pendant les trois décennies suivantes, le pays a continué à s’enfoncer plus profondément dans le gouffre tandis que les rivalités s’envenimaient. Chaque fois que la nation essayait de se remettre sur pied, un autre coup le mettait à genoux, haletant, suppliant pour la vie.
Je ne me suis pas toujours accrochée à mon pays. Dans ma jeunesse, je ne me suis jamais sentie à ma place ici. J’avais envie de m’évader vers des terres étrangères. À 14 ans, mon rêve parut se réaliser. Un lycée de l’Illinois m’accordait une bourse d’études et, si tout allait bien, je poursuivrais mes études supérieures en Amérique. Mes papiers et mon billet d’avion étaient prêts. L’école avait envoyé le formulaire I-20, et ma famille d’accueil m’attendait. Mais deux choses se produisirent cette année-là.
En juillet 2006 éclata la guerre entre Israël et le Hezbollah. Je me souviens que le 12 juillet était inhabituellement froid et lugubre pour un jour d’été. L’armée israélienne effectuait des raids au Liban et l’aéroport international de Beyrouth fut fermé. Comme si cela ne suffisait pas à décourager mes voyages, on me refusa un visa en raison de mon jeune âge. Je me souviens pourtant avoir ressenti une inexplicable sérénité en regardant la mer depuis l’extérieur du consulat.
« Je suis si fière de toi », m’a dit ma mère après notre arrivée à la maison. « Tu étais si confiante. » Nous avons toutes deux éclaté de rire. Puis, son rire se transforma en larmes, et ma retenue toute martiale disparut. Mais dans les années qui ont suivi, je n’ai plus souhaité m’enfuir.
Je suis née dans une famille chrétienne maronite, mais c’est dans une petite école évangélique que j’ai rencontré le Christ. Chaque fois que je pense à cette école, je peux presque entendre les petits cris de joie des enfants qui résonnent dans la cour de récréation hivernale, et le bruit de leurs chaussures qui grincent sur le sol glissant. Je peux presque entendre les chants pendant les cultes du matin et le directeur nous parlant de l’amour merveilleux de Dieu.
En 2006, la guerre ne fut pas la seule à faire irruption dans ma vie. Au milieu de la peur lancinante des frappes aériennes, une paix nouvelle brilla en moi cet été-là. J’avais trouvé Jésus. Je voulais le suivre, même si mes proches — et la société en général — s’y opposaient. En tant que jeune fille, ce ne fut pas toujours chose facile.
Les deux dernières années ont étouffé bon nombre des rêves que je nourrissais autrefois pour ce pays. Mais j’aimerais croire que Dieu n’en a pas encore fini avec le Liban. Mes yeux ont vu les réponses de ses fidèles aux récentes tragédies. Je l’ai vu sur mon propre lieu de travail. La fidélité et la compassion des personnes rattachées au Séminaire théologique baptiste arabe (ABTS) ont laissé une marque indélébile sur moi.
« J’ai grandi pendant la guerre civile libanaise, lorsque l’Église était principalement silencieuse et se cachait », partageait le président de l’ABTS, Elie Haddad, dans un article juste après l’explosion de Beyrouth 2020. « Si vous allez à Beyrouth aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de chercher loin pour voir les mains et les pieds de Jésus. »
Ces mains et ces pieds guérissants sont entrés en action dès le samedi suivant l’explosion de Beyrouth, lorsqu’un taxi est arrivé sur le campus avec une première famille traumatisée. Les vêtements de la famille étaient tachés de sang et de Bétadine. Ils n’avaient rien d’autre que leurs médicaments dans un petit sac en plastique.
Elie écoutait une femme alors que ses mains tremblaient et que ses yeux se remplissaient de larmes. Il l’a réconfortée et lui a assuré que les collaborateurs de l’ABTS feraient tout leur possible pour l’aider.
« Ma mère racontait souvent comment elle avait fui sa maison au début de la guerre civile libanaise, un petit garçon dans les bras et une petite fille à ses côtés », raconte Elie dans une interview. Cette rencontre a ravivé des souvenirs de guerre, mais, dit-il, « elle m’a rappelé que nous sommes ici pour une œuvre divine. Tant que Dieu veut se servir de nous, nous devons être prêts à donner notre vie. »
Je ne saurais me réfugier dans un faux optimisme et dire que le Liban renaîtra de ses cendres. Je ne veux pas donner de leçons sur le besoin de se repentir de la léthargie, sur la nécessité d’endurer la douleur pour que la vie jaillisse de la mort. Aussi beau et sage que cela pourrait paraître, je craindrais que mes paroles ne frisent l’absurde et le dédain dans nos circonstances actuelles. Dans notre infortune, on ne peut parfois s’empêcher de penser que quelque chose d’autre nous attend encore au tournant pour se jeter sur le Liban dès qu’il sera suffisamment faible. Lorsque le peuple libanais n’aura plus nulle part où aller, vendra-t-il son âme à la première voix mensongère qui promettra de le sauver ? Ou confieront-ils enfin leur vie à Celui qui le peut réellement ?
À quoi les gens s’accrochent-ils lorsque tout est en ruines ?
En 1922, le poète moderniste T. S. Eliot publia son célèbre poème « The Waste Land » (« La terre vaine »). Les cinq sections du poème décrivent la vie à Londres au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour dépeindre la fragmentation et la stérilité du monde moderne, le poème utilise la discontinuité rhétorique et la juxtaposition d’allusions à de nombreuses œuvres, dont la Bible, Shakespeare, Saint-Augustin, Baudelaire et l’opéra wagnérien. Le poème reflète également l’époque d’Eliot dans ses références aux gramophones, aux voitures automobiles et aux dactylos.
« Avril est le mois le plus cruel », commence le poème, car le printemps rappelle aux gens les frémissements de la vie qui pourraient les sortir de leur sommeil. Le retour à la vie n’est pas sans douleur. Le poème se termine par la triple répétition du mot sanskrit « Shantih », qu’Eliot traduit par « la paix qui dépasse l’entendement ».
Je me retrouve accrochée à cet espoir, tant pour moi que pour mon pays.
Photo de couverture de Natalya Letunova
Enjoying the Globe Issue?
Order your Deluxe
Print Edition Today!





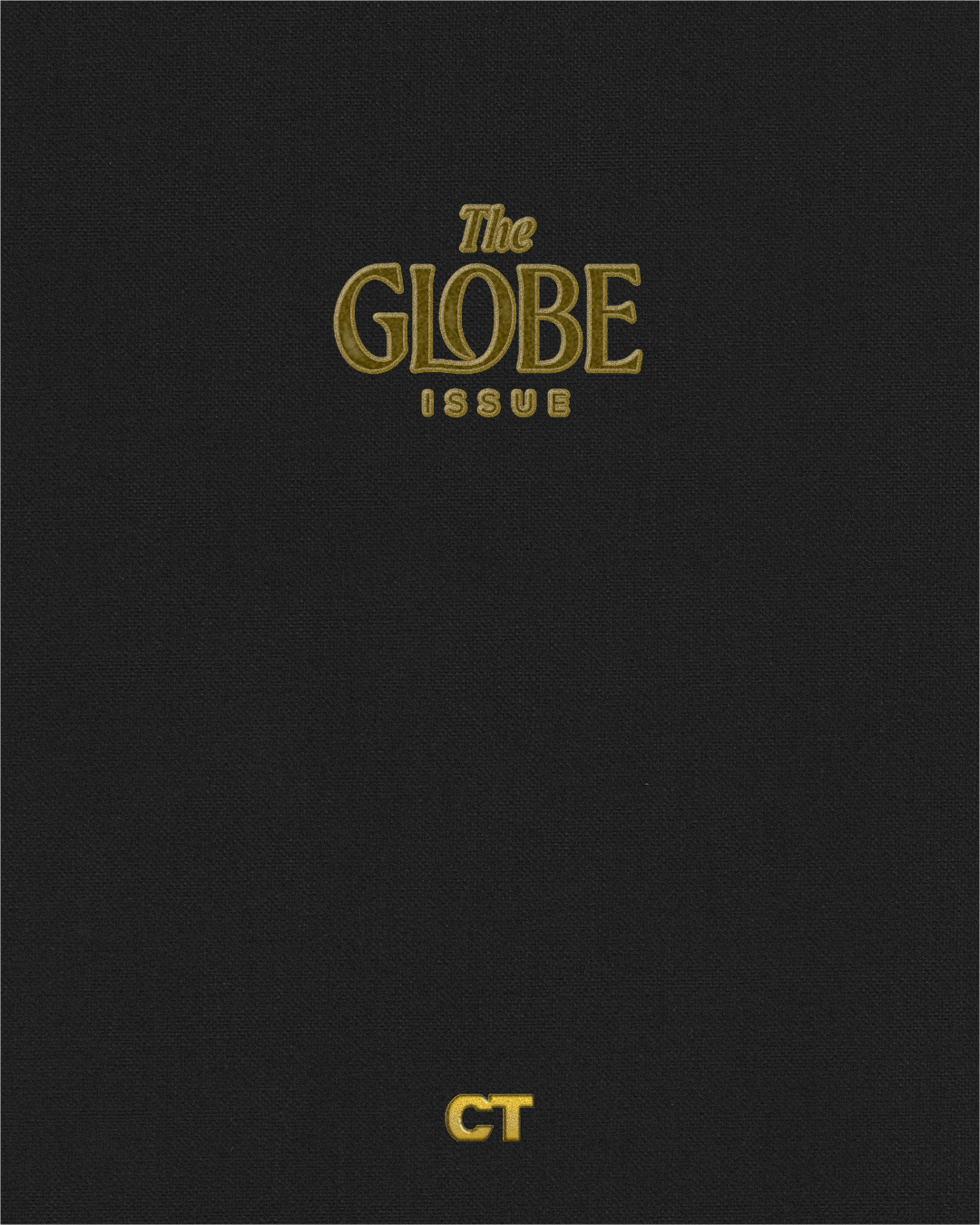








































Share Article